Les biais cognitifs en hse
“Laisse, ça ne prendra pas longtemps. Il ne va rien se passer.”
Cette petite voix intérieure, vous l’avez sûrement déjà entendue. Celle qui vous pousse à ignorer un équipement de protection, à sauter une étape, ou à minimiser un risque.
Et pourtant, même les professionnels les plus expérimentés ne sont pas à l’abri de ce genre de décisions.
Ce n’est pas de la négligence. C’est humain.
Notre cerveau, aussi performant soit-il, utilise des raccourcis mentaux pour gagner du temps et économiser de l’énergie. Ces raccourcis, appelés biais cognitifs, influencent nos jugements et nos comportements… souvent sans que nous en ayons conscience.
En sécurité au travail, ces biais peuvent avoir des conséquences graves.
Ils nous poussent à sous-estimer un danger, à ignorer une procédure, à croire qu’”on maîtrise” alors qu’on s’expose inutilement.
Pour mieux prévenir les accidents, il ne suffit donc pas de rappeler les règles.
Il faut comprendre comment notre cerveau fonctionne sous pression, en routine, ou en situation inhabituelle. C’est la seule façon de construire une culture sécurité durable, alignée avec nos mécanismes mentaux.
Dans cet article, nous allons :
- explorer les origines psychologiques des biais cognitifs,
- identifier les plus courants en milieu professionnel,
- et surtout, voir comment les détecter et les limiter dans nos pratiques HSE quotidiennes.
Comprendre nos erreurs, c’est déjà commencer à les prévenir.
Chapitre I : Comment notre cerveau influence nos décisions
“Ce n’est pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement.”
Cette phrase, on l’a tous entendue. Parfois même prononcée nous-mêmes. Et dans bien des cas, elle n’est pas qu’une excuse : c’est un réflexe cognitif.
Le cerveau humain est une machine brillante, mais imparfaite. Pour faire face à l’avalanche d’informations qu’il doit traiter chaque jour, il a développé des raccourcis mentaux, aussi appelés heuristiques. Ces mécanismes nous permettent de prendre des décisions rapides, souvent utiles… mais parfois trompeuses.
Deux systèmes, une tension constante
Notre cerveau fonctionne selon deux grands modes de pensée :
- Le système 1 : rapide, intuitif, automatique. Il nous permet d’agir vite, mais sans recul.
- Le système 2 : lent, réfléchi, analytique. Il demande plus d’effort et de concentration, mais permet une évaluation plus précise des situations.
En sécurité au travail, c’est souvent le système 1 qui prend le dessus, surtout chez les personnes expérimentées. Elles se fient à leur instinct, à leur vécu, à leur ressenti. Cette réactivité peut être précieuse, mais elle ouvre aussi la porte aux biais cognitifs, qui déforment notre perception du risque.
Les origines des biais cognitifs
Ces biais ne surgissent pas par hasard. Ils sont alimentés par plusieurs facteurs :
- Les préjugés : croyances ancrées, parfois inconscientes, qui filtrent ce que nous percevons.
- Les émotions : peur, stress, confiance excessive… influencent nos réactions, même sans logique apparente.
- Les habitudes mentales : routines, automatismes ou zones de confort qui guident nos actions.
- Les limites de notre attention : nous ne percevons qu’une partie de ce qui nous entoure, souvent influencée par ce que nous attendons de voir.
Dans des conditions normales, ces biais restent en arrière-plan.
Mais sous stress, fatigue, urgence ou charge mentale élevée, ils deviennent dominants. C’est là que les erreurs de jugement se multiplient : gestes mal exécutés, signaux ignorés, décisions hâtives.
Un enjeu HSE majeur
En prévention des risques, ignorer ces mécanismes revient à ne voir qu’une partie du problème. On peut rappeler les consignes, renforcer les procédures, multiplier les EPI… mais si l’on ne tient pas compte de la façon dont les gens perçoivent, évaluent et décident, on rate la cible.
Mieux comprendre ces mécanismes permet d’agir autrement :
- anticiper les conditions dans lesquelles les biais émergent,
- ajuster les consignes pour les rendre plus intuitives,
- former à la vigilance cognitive, au discernement, à l’autoréflexion.
Dans le prochain chapitre, nous verrons quels sont les biais les plus fréquents en matière de sécurité, et comment ils influencent nos comportements sans que nous en ayons conscience.
Chapitre II : Quels sont les principaux biais cognitifs ?
Les biais cognitifs ne sont pas des erreurs ponctuelles, mais des modes de pensée automatiques qui influencent nos jugements sans que nous en ayons conscience. En matière de sécurité au travail, ils peuvent fragiliser les prises de décision, compromettre l’évaluation des risques, et conduire à des comportements inadaptés. En voici dix, parmi les plus fréquents.
1. Biais de disponibilité
Nous avons tendance à juger la probabilité d’un événement en fonction de la facilité avec laquelle nous pouvons nous en souvenir.
Pourquoi c’est un problème ?
Si un salarié n’a jamais vu d’accident dans son service, il aura tendance à croire que le risque est faible, voire inexistant. Cette perception faussée peut le conduire à ignorer des consignes ou à sous-estimer la gravité potentielle d’un écart.
Exemple :
Un opérateur ne met plus ses gants pour manipuler un produit corrosif, car il n’a jamais vu de brûlure chimique autour de lui. Il pense donc que “ça n’arrive pas vraiment”.
2. Biais de confirmation
On sélectionne inconsciemment les informations qui confortent nos croyances, et on ignore celles qui les contredisent.
Pourquoi c’est un problème ?
Ce biais empêche les remises en question. Un salarié convaincu qu’une machine est “sans danger” ne prêtera pas attention aux nouvelles consignes de sécurité la concernant.
Exemple :
Malgré plusieurs alertes récentes sur des incidents, un technicien continue de croire que le nouveau système de levage est “sûr”, car il n’a jamais eu de problème avec lui.
3. Surconfiance
On surestime ses capacités, son expérience ou son contrôle sur la situation.
Pourquoi c’est un problème ?
La surconfiance mène à des prises de risque non perçues comme telles. Elle pousse à ignorer les procédures, sauter les étapes ou minimiser l’utilité des EPI.
Exemple :
Un chef de chantier expérimenté choisit de ne pas baliser une zone de travail en hauteur, estimant qu’il “gère” et que “personne ne viendra là de toute façon”.
4. Biais d’attribution
On attribue ses succès à soi-même, et ses erreurs à des causes externes (matériel, collègues, environnement…).
Pourquoi c’est un problème ?
Ce biais empêche l’auto-analyse. Il bloque l’apprentissage à partir des incidents et peut nuire au travail d’enquête ou à l’amélioration continue.
Exemple :
Un agent glisse sur une surface mouillée et rejette la faute sur le service de nettoyage, alors qu’il a ignoré un marquage au sol signalant un sol glissant.
5. Effet Dunning-Kruger
Les personnes les moins compétentes ont tendance à se croire plus compétentes qu’elles ne le sont.
Pourquoi c’est un problème ?
Ce biais est particulièrement dangereux pour les nouveaux ou les intérimaires, qui peuvent surestimer leur niveau de maîtrise et donc prendre des risques sans en avoir conscience.
Exemple :
Un nouvel opérateur pense avoir bien compris la procédure de consignation, mais n’a pas identifié un point de verrouillage critique. Il agit seul, sans demander de validation.
6. Malédiction du savoir
Une personne experte oublie que les autres ne partagent pas les mêmes connaissances.
Pourquoi c’est un problème ?
Cela peut entraîner des consignes incomplètes ou trop vagues, des formations peu adaptées ou des erreurs de communication.
Exemple : un formateur sécurité omet d’expliquer une étape essentielle lors d’un briefing, pensant qu’elle est “connue de tous”, alors qu’un salarié débutant ne la connaît pas.
7. Biais de représentativité
On évalue une situation par analogie avec une autre, supposée similaire, sans analyser ses spécificités.
Pourquoi c’est un problème ?
Cela peut conduire à appliquer des solutions inadaptées ou à négliger les différences techniques ou organisationnelles.
Exemple :
Une machine neuve semble identique à l’ancienne, mais possède un mécanisme de sécurité supplémentaire. L’utilisateur l’ignore et l’utilise comme l’ancien modèle, ce qui provoque un blocage ou un danger.
8. Biais de statu quo
On préfère maintenir les pratiques existantes, même si elles sont dépassées ou moins sûres.
Pourquoi c’est un problème ?
La résistance au changement est un frein majeur à l’amélioration continue et à l’adoption de nouvelles mesures de sécurité.
Exemple :
Malgré la mise à jour d’un protocole de manutention, certains agents continuent d’appliquer l’ancienne méthode, “par habitude”, sans vérifier si elle est toujours conforme.
9. Biais d’optimisme irréaliste
On croit que les accidents arrivent aux autres, pas à soi-même.
Pourquoi c’est un problème ?
Ce biais crée un sentiment d’invulnérabilité, qui pousse à minimiser les dangers ou à ignorer les alertes.
Exemple :
Un salarié traverse régulièrement un entrepôt sans gilet haute visibilité, convaincu qu’il est “assez prudent” pour éviter les chariots.
10. Effet d’ancrage
La première information reçue influence durablement nos jugements, même si des données plus récentes la contredisent.
Pourquoi c’est un problème ?
Une mauvaise première impression sur un risque peut fausser toutes les évaluations suivantes.
Exemple :
Si un salarié entend au départ que “l’outil n’a jamais posé de problème”, il peut négliger des incidents récents ou ne pas signaler une anomalie.
Tous ces biais ont un point commun : ils agissent en silence.
Pour les contrer, il faut d’abord les connaître, les nommer, et les reconnaître dans les pratiques quotidiennes. Ce n’est qu’à cette condition qu’une culture sécurité peut vraiment progresser.
Dans le chapitre suivant, nous verrons comment agir concrètement pour réduire leur impact dans les organisations.
Chapitre III : Comment gérer efficacement les biais cognitifs ?
Comprendre les biais cognitifs est une première étape. Mais pour qu’ils ne deviennent pas des facteurs aggravants en matière de sécurité, il faut mettre en place des actions concrètes, durables et adaptées au terrain.
Voici cinq leviers essentiels pour mieux gérer ces biais et renforcer la prévention.
1. Former et sensibiliser en continu
Les biais cognitifs ne disparaissent pas : ils font partie de notre fonctionnement mental. En revanche, nous pouvons apprendre à les reconnaître.
Former les équipes à ces mécanismes permet :
- de mieux comprendre ses propres réactions,
- d’identifier les biais dans les comportements collectifs,
- de réagir avec plus de discernement face aux risques.
La sensibilisation doit aller au-delà des rappels théoriques. Elle peut prendre la forme :
- d’ateliers interactifs,
- de retours d’expérience analysés collectivement,
- d’exercices sur des cas concrets vécus dans l’entreprise.
L’objectif n’est pas de moraliser, mais de développer une vigilance cognitive partagée.
2. Promouvoir une culture de sécurité proactive
Une organisation qui tolère les écarts ou ne valorise pas les remontées d’alerte renforce inconsciemment les biais.
À l’inverse, une culture où :
- le doute est permis,
- les questions sont encouragées,
- les erreurs sont analysées collectivement,
… permet de créer un environnement où les biais ont moins d’emprise. Chacun se sent autorisé à remettre en question un automatisme ou à alerter sur une situation inhabituelle.
Cela suppose un cadre de confiance, où l’on ne juge pas les erreurs, mais où on les utilise pour progresser.
3. Encourager la réflexion avant l’action
Les biais cognitifs s’expriment le plus souvent dans l’urgence, la routine ou l’excès de confiance.
Favoriser une pause réflexive avant certaines tâches critiques peut faire toute la différence. Cela peut prendre des formes simples :
- une auto-question de type : “Ai-je bien tous les éléments pour décider ?”
- une relecture à deux d’un plan d’intervention,
- ou même un simple “stop 30 secondes” avant une action à risque.
Ces micro-pauses permettent de basculer du mode intuitif au mode délibératif, réduisant ainsi le risque de décision biaisée.
4. Utiliser des check-lists et des procédures claires
Standardiser les pratiques est l’un des moyens les plus puissants pour limiter les biais liés à la mémoire, aux habitudes ou à la surconfiance.
Les check-lists bien construites :
- guident l’attention sur les points critiques,
- permettent de vérifier chaque étape sans oubli,
- réduisent l’impact des interprétations personnelles.
Elles sont particulièrement efficaces pour les tâches répétitives, les interventions à plusieurs ou les situations de changement (maintenance, consignation, mise en service…).
5. Renforcer le rôle du leadership de terrain
Les managers, chefs d’équipe et référents sécurité ont une influence directe sur les comportements. Par leur attitude, ils peuvent :
- normaliser le recours à l’analyse,
- valoriser les bonnes pratiques,
- ou au contraire, minimiser les risques par surconfiance ou banalisation.
Former ces acteurs à la notion de biais, et leur donner les outils pour animer la prévention autrement, permet de transformer la posture managériale. Il ne s’agit plus seulement de contrôler, mais de créer les conditions d’un discernement collectif.
Gérer les biais cognitifs, ce n’est pas corriger l’humain. C’est adapter les systèmes pour que l’humain prenne de meilleures décisions.
Conclusion
Les biais cognitifs ne sont pas des défaillances individuelles. Ce sont des mécanismes universels, automatiques et profondément humains. Mais en matière de sécurité au travail, ils peuvent devenir de véritables pièges invisibles.
Ignorer leur existence, c’est s’exposer à des erreurs évitables.
Les reconnaître, c’est ouvrir la voie à une prévention plus fine, plus réaliste, plus humaine.
Parce qu’un salarié qui contourne une consigne n’est pas toujours négligent.
Parce qu’un manager qui banalise un risque ne le fait pas forcément par désinvolture.
Mais parce que, dans le feu de l’action, sous pression, dans la routine ou l’urgence, notre cerveau prend parfois des raccourcis risqués.
Agir sur les biais cognitifs, c’est :
- Mieux former, pour que chacun comprenne les limites naturelles de son jugement ;
- Mieux concevoir, pour éviter que l’erreur ne devienne la seule issue logique ;
- Mieux manager, pour favoriser un climat où le doute, la prudence et le dialogue sont encouragés.
En intégrant cette dimension dans nos démarches HSE, nous ne faisons pas que renforcer la conformité.
Nous renforçons la lucidité, la vigilance et l’intelligence collective.
Et c’est sans doute là, aujourd’hui, l’un des plus grands leviers d’évolution de la culture sécurité.
Références et sources
Kahneman, D. (2011). Système 1 / Système 2 : Les deux vitesses de la pensée. Flammarion. L’ouvrage de référence sur le fonctionnement du cerveau humain et les mécanismes cognitifs à l’origine des biais.
Reason, J. (1990). Human Error. Cambridge University Press. Un classique de la sécurité industrielle qui explique comment les erreurs humaines s’inscrivent dans des systèmes.
Articles psychologie.net : les 12 biais cognitifs les plus courants. Comment nous affectent-ils ?


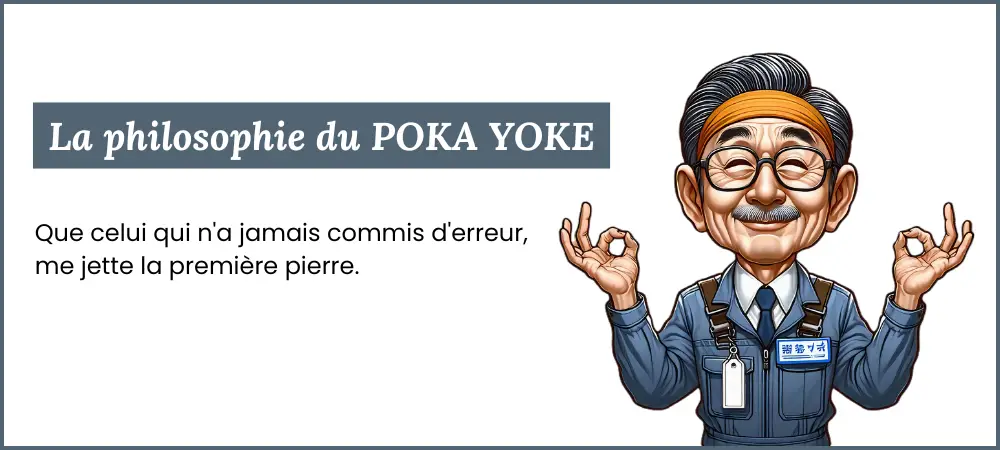

Ping : Ligne de tir en sécurité : prévenir l’accident invisible - guidehse.fr
Ping : Accidents du travail, arrêtons de blâmer les comportements
Ping : Danger invisible : de l’erreur individuelle au déficit systémique - guidehse.fr